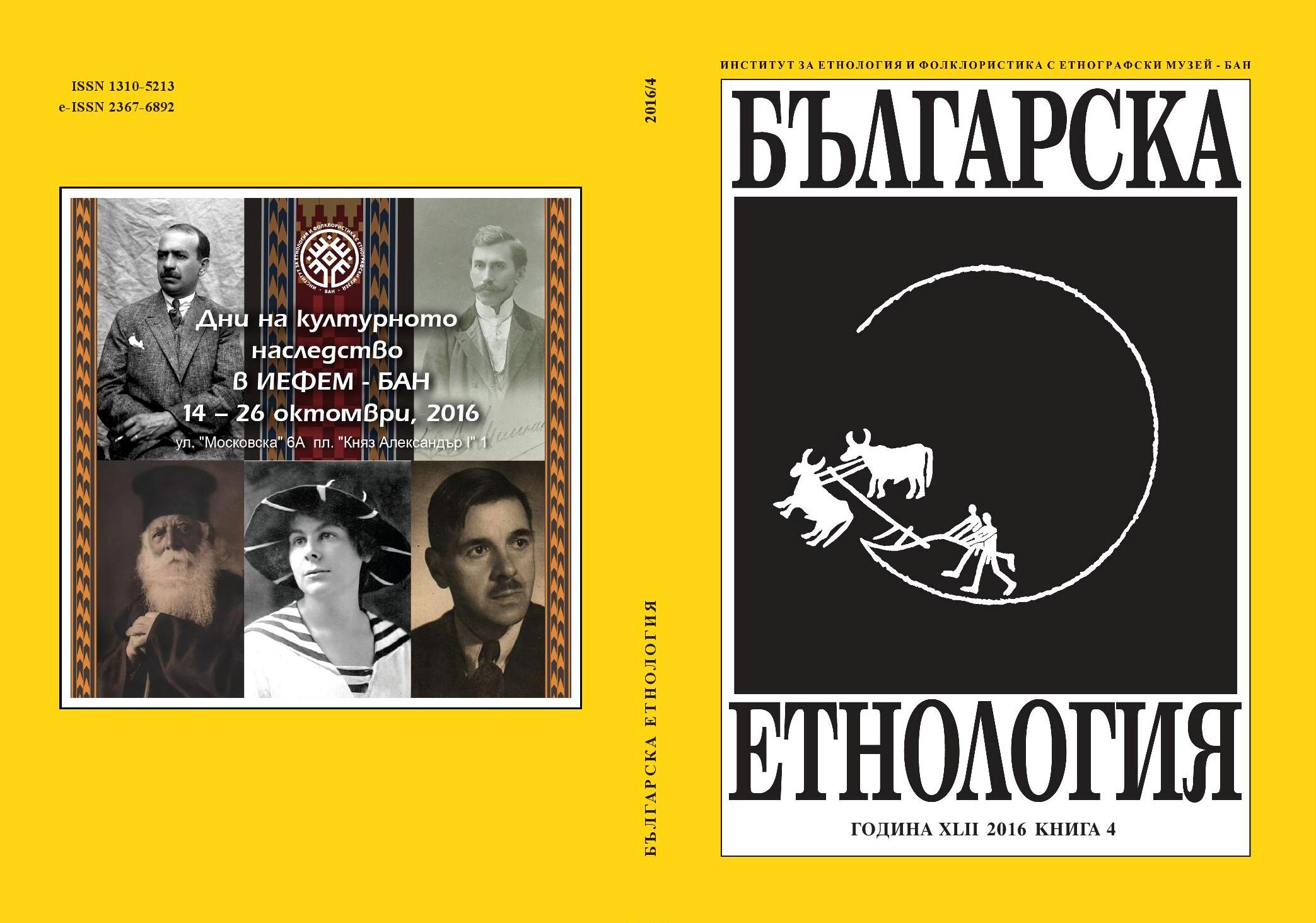
We kindly inform you that, as long as the subject affiliation of our 300.000+ articles is in progress, you might get unsufficient or no results on your third level or second level search. In this case, please broaden your search criteria.
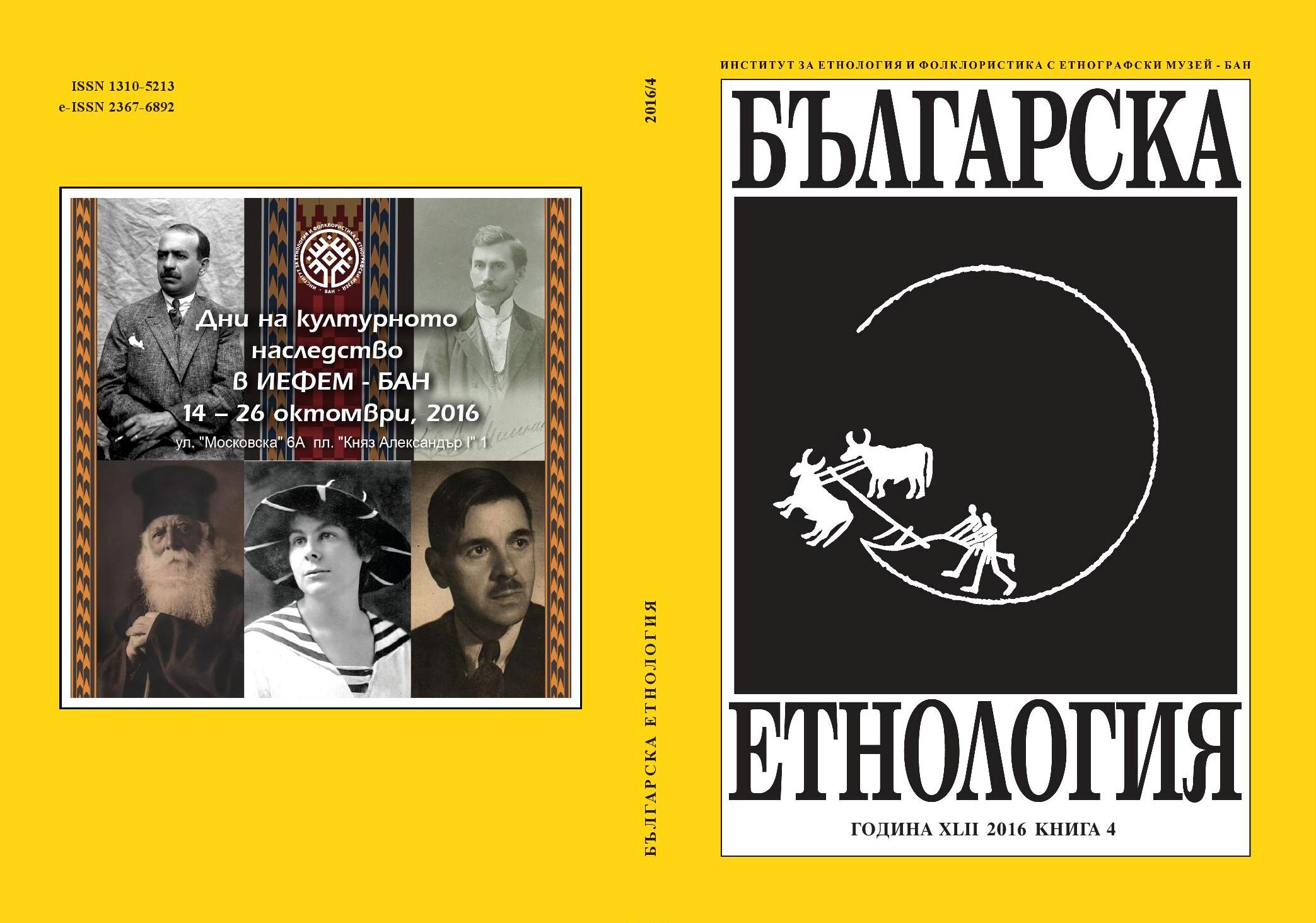
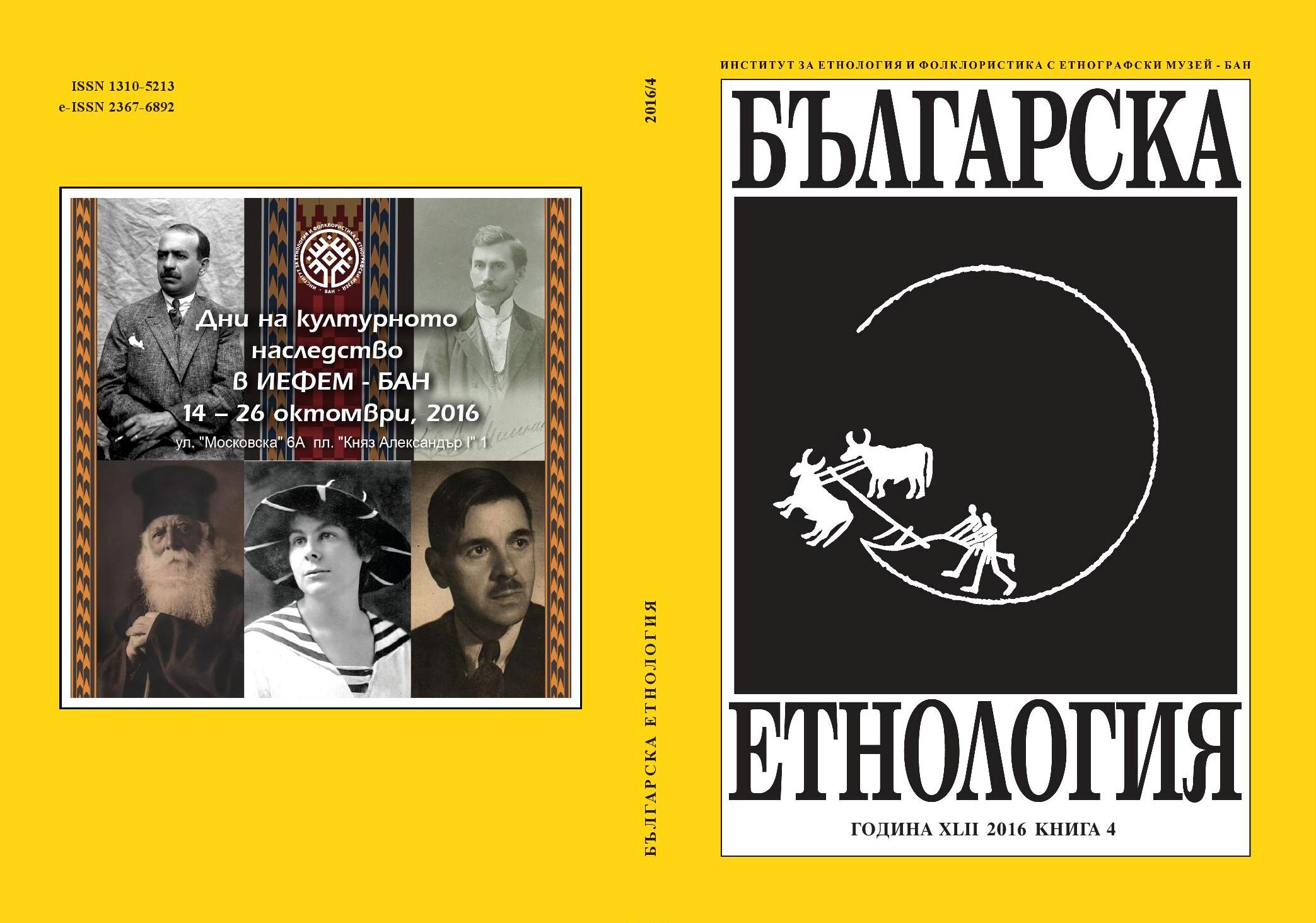
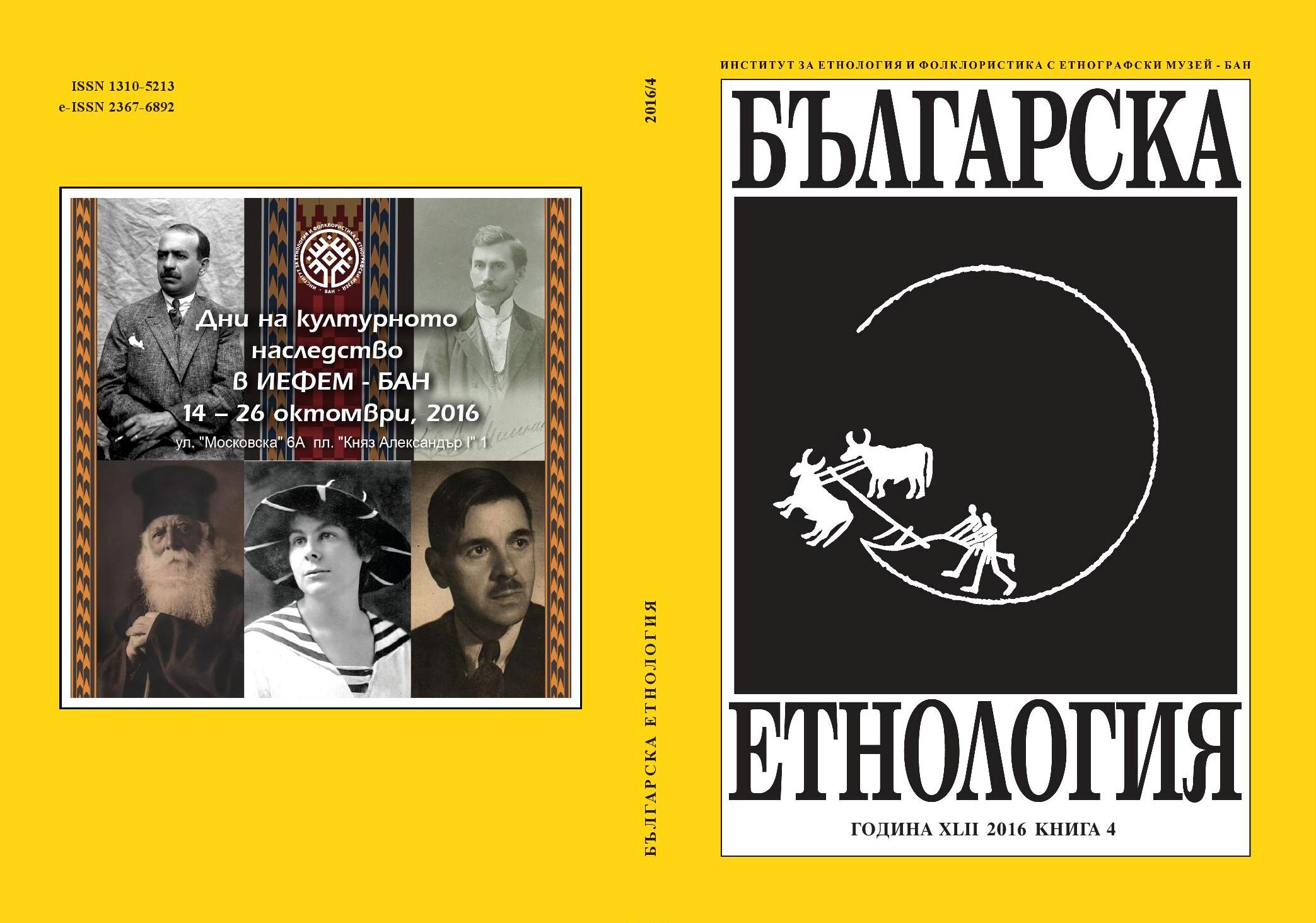

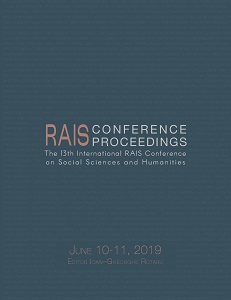
ABSTRACT: Melancholy has long been considered a negative state of being. However, negative interpretations fail to appreciate its positive potential. Melancholy and its effect can potentially benefit, not just an individual but a community. Changing attitudes towards the idea of melancholy in American culture may happen if the strategy of defining it is adapted. This paper focuses on how Emilio Uranga defines melancholy and how his philosophy can benefit a better understanding of melancholy in a communal dimension. The role of communal melancholy in Korean culture after colonialization exemplifies the way in which melancholy presupposes and manifests freedom and is a condition of authenticity.
More...
How do different arts - cinema, theater, literature, music - tell the story of the transition to democratization? This was the main topic discussed at a Round Table, held in the end of September at G8 Cinema by researchers for the project ‘The Transition after 1989 - Interpretations of Historical Change, Social Experience and Cultural Memory in Contemporary Bulgarian Literature’. The cultural heritage of Transition was at the center of discussions about the memory, the clash between the image of freedom and the market mechanisms of governing culture and art and the role of the media.
More...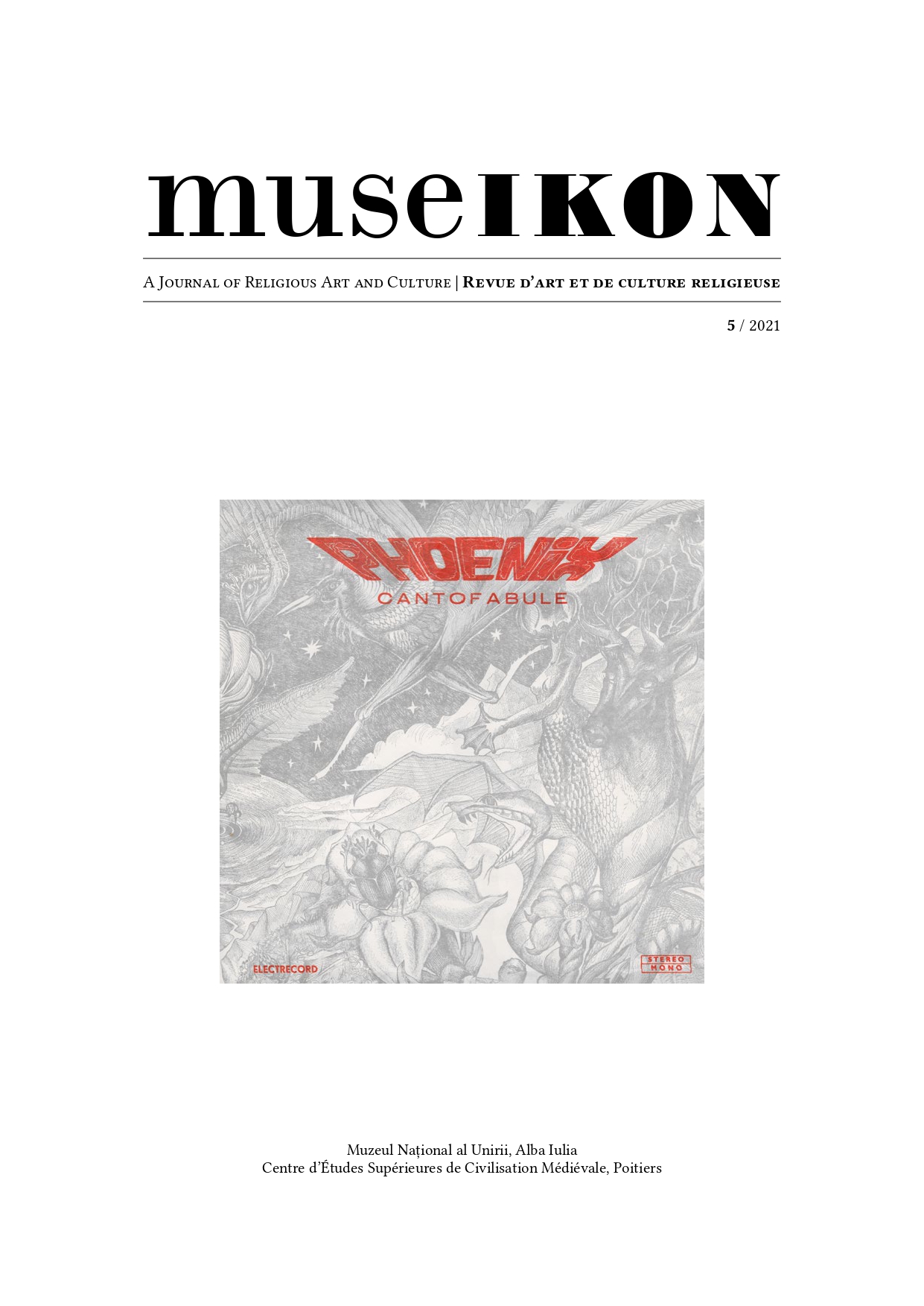
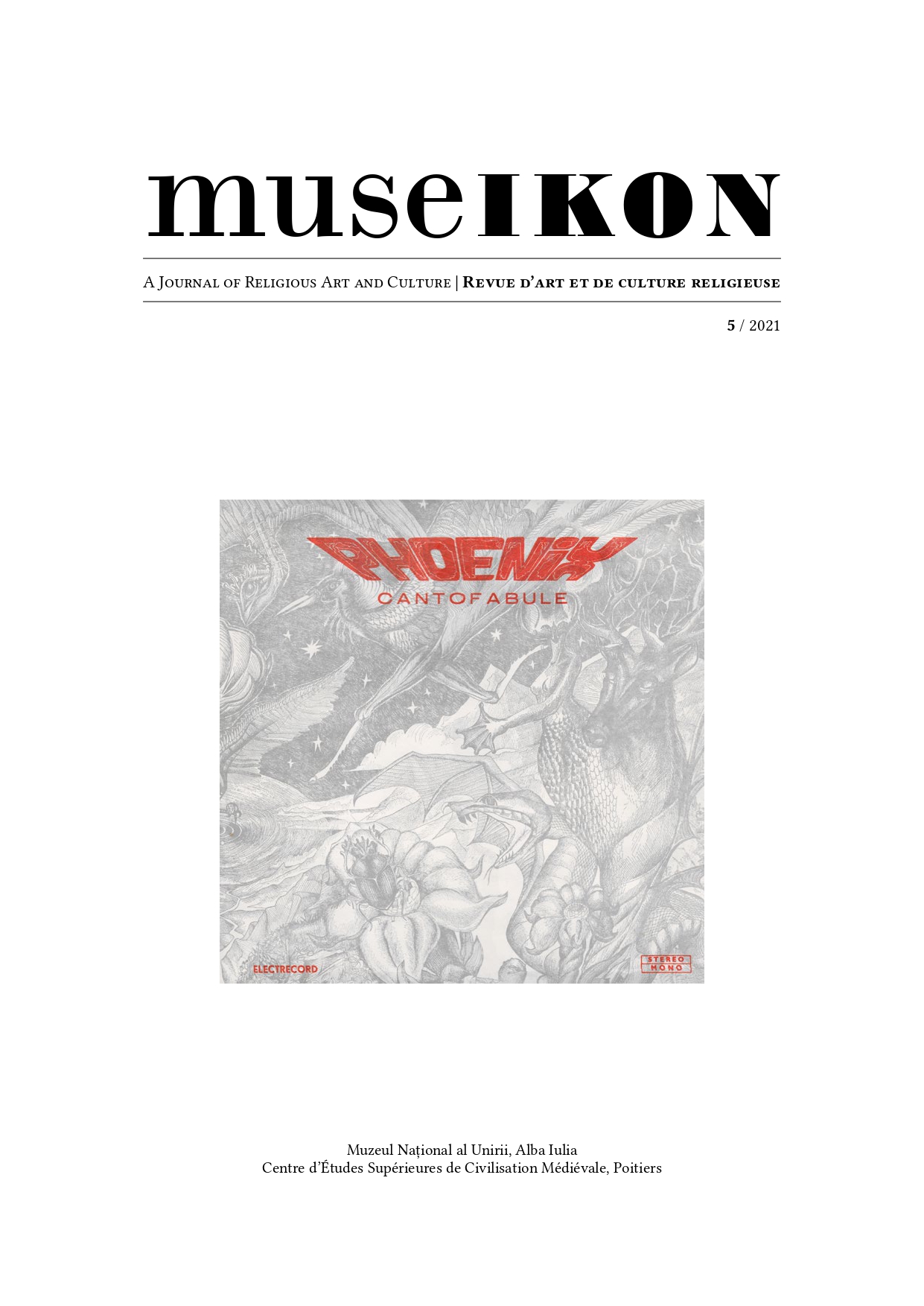
Exhibitions. Conferences. Projects. Databases. Latest publications.
More...
Un siècle après la publication des premières recherches sur l’église Sainte-Parascève de Tălmăcel, de nouvelles études permettent de reconstituer l’histoire de la fondation du village transylvain à la fin du xviiie siècle. Elles mettent en évidence la valeur architecturale et le caractère représentatif des composantes artistiques dont l’église du village a été dotée à différents moments historiques; caractéristiques qui ont déterminé le classement de cette église en tant que monument historique. La présente étude se propose de réexaminer les recherches publiées jusqu’à présent et poursuit l’investigation grâce, entre autres, aux apports fournis par la restauration de l’ensemble mural. Les informations inédites identifiées dans les documents, les notes transcrites dans les anciens livres liturgiques des archives paroissiales, permettent d’identifier la signature de l’artiste Ioan de Poplaca, à qui l’on devrait certaines parties de la peinture murale de l’église. Sa contribution, jusqu’ici inconnue, peut être désormais différenciée de celle de l’autre peintre, Panteleimon. La différenciation de leur activité à Tălmăcel permet de mettre en évidence quelques particularités stylistiques propres à chacun de nos deux artistes; caractéristiques qui, par analogie, nous pouvons également identifier dans d’autres de leurs oeuvres. À titre subsidiaire, l’article permet de reconstituer leurs biographies.
More...
Après avoir reconfirmé la datation de Camille Enlart (vers 1421 ou 1421-1424) et identifié le comman-ditaire (l’évêque de Limassol Barthélemy Gui) dans une inscription fragmentaire, la présente étude explore: d’une part, les modèles des inscriptions en langue vernaculaire française de Pyrga (Chypre); d’autre part, la lo-gique du programme iconographique et le contexte culturel que sous-tend cette dernière. Dans la première par-tie, l’analyse des inscriptions de la chapelle prouve que le concepteur du décor peint a suivi un modèle manuscrit, sans doute un psautier avec un grand cycle d’enluminures. L’étude évoque trois termes de comparaison célè-bres: le Psautier de la reine Ingeburge (Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé, 9 – tournant du xiiie siècle), le psautier de l’évêque Henri de Blois (Londres, British Library, Cotton Nero C iv – vers 1160) et le livre d’images de Marie de Rethel (Paris, Bibliothèque nationale de France, n. acq. fr. 16251 – vers 1285). Dans la source manuscrite reconstituée, les inscriptions en ancien français étaient probablement transcrites en tant que tituli, d’après une typologie tripartite: noms de fêtes religieuses, groupes nominaux ayant une fonction analogue et légendes sous forme d’énoncés introduits par l’adverbe coument. La langue des inscriptions de Pyrga, un français d’Outremer, présente les traits particuliers des scriptae chypriotes de la fin du Moyen Âge. De plus, on constate que la déco-ration de la chapelle inscrit le monument de Pyrga dans la catégorie des chapelles royales de l’Europe occidentale (xive et xve siècles). Le transfert du codex à la paroi concerne non seulement les images, mais également les textes qui accompagnent ces dernières. L’auteur s’intéresse ensuite à la disposition symétrique de la décoration dans les deux travées de la chapelle, ainsi qu’à la manière dont cette disposition accentue l’Uniatisme catholique-orthodoxe. La logique dos-à-dos de la décoration émule celle des icônes à double face – termes de comparaison directs pour la chapelle – notamment leur choix d’apparier deux scènes : la Crucifixion / la Mère de Dieu. Le con-cepteur du décor peint souhaitait évoquer l’osmose de deux églises: une église latine, orientée vers l’Est; la sug-gestion d’une église byzantine, orientée vers l’Ouest. Cela explique le choix particulier de la décoration des voûtes (christologique pour la travée Est et mariale pour la travée Ouest), la double représentation de l’An-nonciation (pour marquer l’orientation des deux églises) et le choix d’une composition de type pala d’altare pour la paroi Est, tandis que la paroi Ouest imite la décoration des templons byzantins. L’osmose des deux églises est indiquée de manière encore plus claire par le choix de représenter les martyriums des saints Étienne (signifiant l’Orient) et Laurent (signifiant l’Occident) au-dessus des entrées latérales. Ce serait une allusion à l’osmose des corps de ces saints dans la Coniunctio corporum sanctorum Stephani et Laurentii (bhl 4784b). Après une réévaluation du texte fragmentaire (aujourd’hui perdu) de l’inscription dédicatoire, il est évident que la dédicace proprement dite concernait l’Assomption de la Vierge. Qui plus est, l’osmose Est-Ouest était de nou-veau indiquée par la représentation dans un même cadre de la Dormition de la Mère de Dieu (sujet à connotation byzantine) et du Couronnement de la Vierge (thème occidental par excellence). Les textes littéraires des xive et xve siècles confirment la fixation chypriote de l’appariement de la Mère de Dieu avec la Passion du Christ, de même que plusieurs autres choix de la décoration de Pyrga. La signification de la décoration devait être multiple, en rapport avec la triple utilité du bâtiment: chapelle funéraire (pour Barthélemy Gui), chapelle royale (pour le couple Janus de Lusignan-Charlotte de Bourbon) et point d’entrée au monastère de Stavrovouni, qui hébergeait des reliques de la Sainte Croix.
More...
Dans les églises de rite byzantin, les ‘portes royales’ de l’iconostase se distinguent par leur richesse, leur étrangeté et leurs mystérieux ornements. Malgré le rôle décoratif essentiel qu’ils jouent, la finalité de ces traits caractéristiques demeure souvent obscure. Le manque d’explication cohérente devient ainsi l’un des défis scientifiques les plus stimulants à relever, afin d’en clarifier la signification. Étant donné que les recherches en ce sens sont encore absentes du panorama critique de l’histoire de l’art post-byzantin, mettre l’accent, dans une analyse du symbolisme des ‘portes royales’, sur une province lointaine telle que le Maramureș pourrait surprendre. La présente étude se propose toutefois d’interpréter la décoration des ‘portes royales’ au sein du cadre strict de l’espace rituel et culturel byzantin dans le territoire des Carpates du Nord à l’époque prémoderne, en s’appuyant, pour ce faire, sur des écrits religieux contemporains des objets étudiés. Puisque ces écrits, à travers les traductions en langue vernaculaire, ont influencé la culture populaire de la région, la décoration des ‘portes royales’ doit être interprétée en clé mariale. Aussi, tous les traits caractéristiques, les détails et les significations de ces portes illustrent la porte du ciel, attribut caractéristique de la Mère de Dieu dès l’incarnation du Christ. Il semblerait donc que le thème central en soit l’Annonciation. Ainsi, l’étude se propose de montrer la manière dont ce thème a été amplifié et diversifié sous forme de cycle iconographique composé de quatre parties, que l’on peut observer à la fois en peinture et en sculpture. Les sculptures témoignent d’un emploi particulier du langage métaphorique, exprimé d’une manière allégorique et emblématique, à travers laquelle les ‘portes royales’ sont transformées en pièces centrales et complexes de l’iconostase. Plusieurs prophéties concernant la Venue du Sauveur grâce à une vierge ont été choisies et représentées dans la sculpture des ‘portes royales’ de la région des Carpates du Nord, qui devient le centre d’un développement iconographique particulier. Sans doute, les disputes religieuses ont-elles façonné la culture spirituelle des croyants orthodoxes des Carpates, à l’époque turbulente de la pré-modernité. À cet égard, la rhétorique du langage artistique visuel se pose en miroir des témoignages apportés par les documents, les inscriptions et les collections folkloriques des communautés de rite byzantin. Situé à un carrefour de civilisations, l’art sacré de Maramureș contribue à une meilleure compréhension de la signification et de l’évolution de ces ‘portes royales’ à l’époque post-byzantine; mais il nourrit également l’étude de l’histoire de l’art européen dans son ensemble.
More...
This study identified the icon of Virgin Moscovita and the icon of the Holy Mandylion, described in Konstantinos Dapontes’ writings, with the icon of the Virgin and the icon of the Holy Mandylion preserved in his family monastery Evangelistria in Skopelos island. We can now retrace the “biography” of these two artefacts, the history of their creation, donation, and multiple “transfers” of the two icons. This study is an important contribution to the history of the early modern period in the Balkans. The icon of the Virgin Moscovite was donated to Konstantinos Dapontes by his benefactor Konstantinos Mavrocordatos in 1741 in Iasi, and the the icon of the Holy Mandylion was donated to Dapontes by his “maître spirituel”, the patriarch of Antioch Sylvester in 1762.
More...
The Library of the Orthodox Metropolitan See of Moldavia and Bucovina in Iaşi preserves over a thousand copies of old Greek books. There are only ten manuscripts in this collection, one of which was com-missioned by Constantin Brâncoveanu, Prince of Wallachia. The collection consists mainly of Greek prints of various origins, some of which can be traced back to the library of the Princely Academy of Iași, succeeded by the Mihăileană Academy. Other volumes originate in the library of the Theological Seminary of Socola, founded by Veniamin Costachi Metropolitan of Moldavia, who donated his personal library to the Iași foundation. Sev-eral references come from the private collections of high hierarchs, while some books were collected from various Moldavian monasteries, especially from those who used to be metochia of the Greek Patriarchates and the great monasteries under their jurisdiction. This article evaluates the importance of the prints according to their dating, place of publication, owners, and contents (generally didactic books, but also polemical books of a religious nature). It also seeks to reconstruct the historical context of their circulation in Moldavia and the circumstances in which they came into the possession of the Metropolitan See of Moldavia and Bucovina. The analysis provided takes into account prosopographical investigations, the history of the Moldavian educational institutions, and the examination of the notes (mostly in Greek) on the prints.
More...
Le musée ‘Trésors spirituels de l’Ukraine’ à Kiev comprend plus de 400 icônes allant du xve au xixe siècles. Dans cette collection, plusieurs exemplaires témoignent d’une série de traits stylistiques indiquant que leur origine pourrait se situer dans la Ruthénie des Carpates, de Pokutia ou de Maramureș. Ces icônes se caractérisent par une forme simplifiée; une palette de couleurs limitée; une composition schématique; des formes stylistiques bien connues aux siècles précédents; un fond doré gravé; et des cadres en bois particulièrement sculptés. Le présent article décrit six de ces icônes : l’icône de la Mère de Dieu sur Trône, peinte par Michail Popovich de Kolomyia, dont les oeuvres se trouvent dans les églises de Budeşti-Josani et de Budeşti-Susani ; l’Annonciation de la fin du xviie siècle, oeuvre du peintre d’icônes de Hǎrnicești à Maramureș et Bǎlan-Josani ; une icône du xviiie siècle, la Descente du Saint-Esprit, peinte dans un style similaire à celui de l’icône de Saint Nicolas de Shelestovo, près de Moukatchevo (aujourd’hui au Musée de l’Architecture et de la Vie Populaires d’Oujhorod) ; et trois icônes – Christ Pantocrator, Théotokos Hodegetria et Archange Michel – provenant du même atelier que les Trois Saints Hiérarques du Musée d’Ethnographie Régionale d’Ivano-Frankivsk.
More...
This paper represents a continuation of previous publications: “The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms. Collective Research” (Museikon, 3, 2019, p. 67-140—hereafter abbreviated as Musical Instruments 2019); “The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (2): Collective Research” (Museikon, 4, 2020, p. 257-302—hereafter ab-breviated as Musical Instruments 2020); and “The Musical Instruments in the Early Vernacular Trans-lations of the Psalms (4): Collective Research” (Museikon, 5, 2019, p. 91-107—hereafter abbreviated as Musical Instruments 2021). The current paper represents the finalisation of this group of articles.
More...
Cet article se propose d’étudier, dans leur contexte, différents accessoires ecclésiastiques russes, tels que des épitaphes, des vêtements de prêtres et des objets eucharistiques, qui se trouvent dans les églises et dans les monastères de la préfecture de Réthymnon - district passé sous le contrôle russe entre 1897 et 1909 - et qui datent de l’époque de l’Autonomie Crétoise (1898-1913). A la lumière des relations entre la Russie et les institutions socio-politiques crétoises; en tenant compte du fait que la Russie n’entretenait pas, avec cette île, des liens commerciaux aussi développés qu’avec les autres secteurs de la Grèce, l’auteure s’intéresse aux mécanismes de transfert et d’acquisition d’objets liturgiques russes, ainsi qu’à la reconstitution d’une cartographie. Aussi, les découvertes sont-elles étudiées dans le contexte des stratégies politiques - clés du soi-disant « soft power » déployé par la Russie impériale pour asseoir son pouvoir dans la région - employées afin de préserver et soutenir l’orthodoxie contre la propagande catholique et protestante.
More...
L’article explore un aspect peu étudié de la réception de l’art religieux russe par les communautés orthodoxes balkaniques du xixe siècle: l’image de la Russie et de ses peuples, que les moines collectant les aumônes (zeteia) avaient relayée, à leur retour, dans leurs monastères d’origine et/ou aux communautés environnantes. L’objectif principal des voyages entrepris par ces moines était de convertir une partie considérable de dons et bénéfices collectés en une variété d’objets ecclésiastiques précieux et/ou revêtements d’icônes. La présente étude analyse trois récits différents de deux de ces voyages, effectués dans les années 1860 et au début des années 1890 par des moines athonites. Elle explore également deux approches dans cette collecte d’aumônes (traditionnelle vs entrepreneuriale) et la manière dont le regard porté par les voyageurs en question sur la société russe, ses institutions religieuses, ses moeurs et ses habitudes, a pu en être affecté.
More...
L’article nous présente la manière dont trois histoires, avec des finalités très différentes, s’avèrent en réalité interconnectées. La première histoire est celle de saint Antoine Petchersky (xe-xie siècle), père du monachisme russe et fondateur de la Laure des Grottes de Kyïv; la deuxième concerne un monastère du Mont Athos, où ce saint aurait vécu pendant un certain temps au xie siècle; la troisième nous parle d’un objet qu’il aurait porté. La présente étude permet d’explorer la rivalité entre Grecs et Russes au Mont Athos dans la seconde moitié du xixe siècle. Elle permet également d’interroger la question des ‘faux’ objets et la pertinence culturelle de ces derniers.
More...
L’article présente une série d’icônes et d’objets liturgiques provenant du trésor du monastère Rakovica à Belgrade, en Serbie. Plusieurs exemples, datant de différentes périodes, témoignent de l’influence culturelle russe sur le milieu local serbe. Le monastère possède six icônes peintes dans le Palais des Armures du Kremlin à Moscou vers la fin du xviie siècle. Ces icônes, qui comptent parmi les témoins conservés les plus anciens, nous renseignent sur les relations serbo-russes au sein de la vie religieuse de Belgrade. D’innombrables guerres ont jalonné l’existence du monastère Rakovica, ce qui explique que le trésor soit aujourd’hui relativement modeste. Il comprend, par exemple, quelques icônes russes des xixe et xxe siècles, principalement des artefacts produits en série, sans valeur artistique significative. Toutefois, les revêtements en argent de trois de ces icônes nécessitent une analyse approfondie. Aussi, le trésor comprend-il plusieurs livres liturgiques imprimés à Moscou ou dans la Laure des Grottes de Kyïv, de même que deux objets liturgiques.
More...